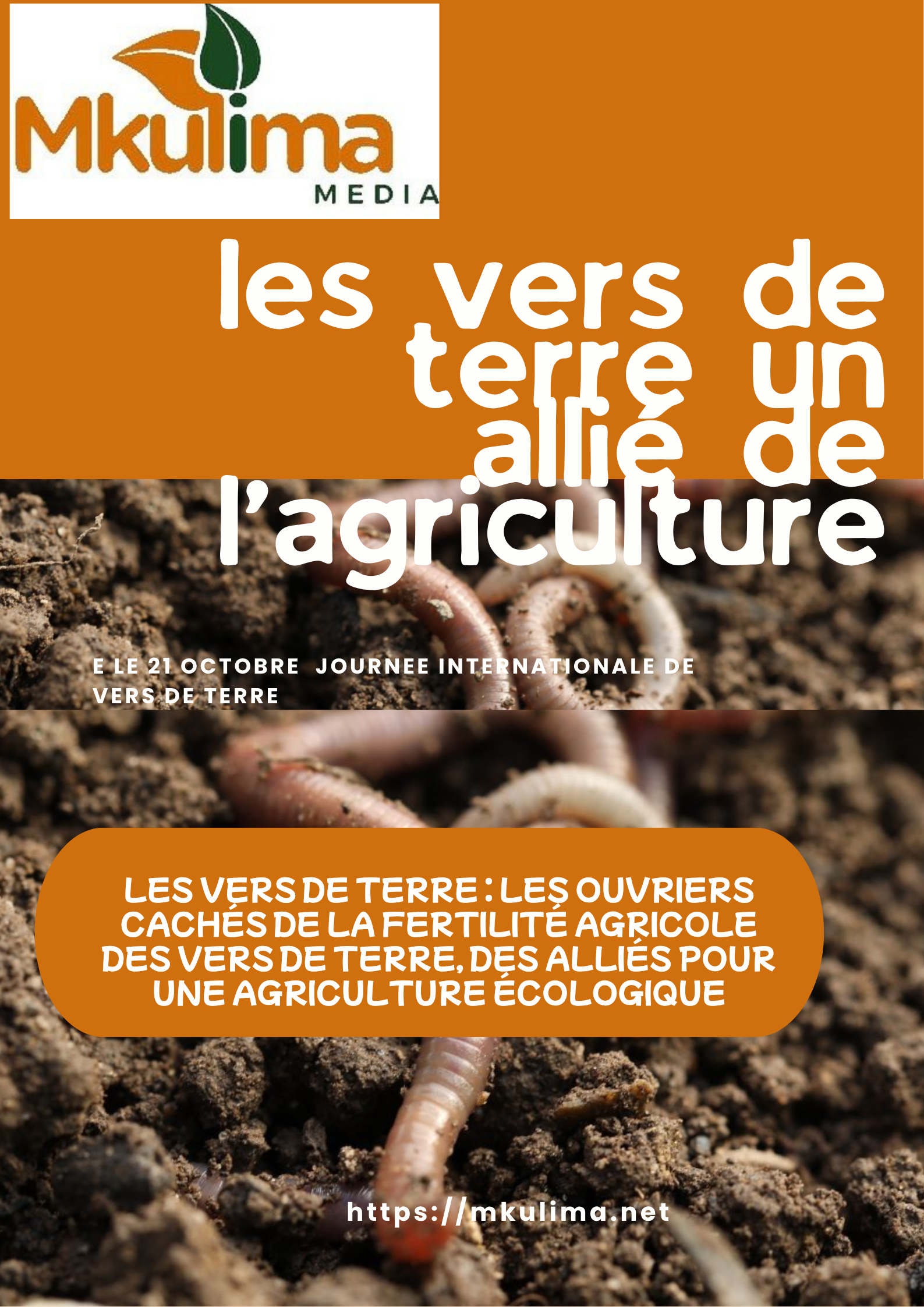En quelques mois, plus de quinze hippopotames ont été abattus aux abords de Katogota, dans la plaine de la Ruzizi (Sud-Kivu), compromettant un sanctuaire naturel jadis florissant. Conséquence directe du braconnage organisé et de la fragilité sécuritaire, cette hécatombe fragilise l’écosystème local, menace les revenus touristiques et ébranle la cohésion sociale d’une communauté qui, pourtant, misait sur la protection de ces géants aquatiques pour se développer.
La société civile locale parle déjà d’un « écocide » qui détruit « plus de 20 ans de dur labeur » consacrés à remettre sur pied ce sanctuaire naturel. Les premières alertes avaient été lancées dès février 2025 par les écologistes, mais jusqu’à présent « rien n’est arrêté ». Les images de carcasses flottant à la surface ont choqué la population ; dans les villages riverains, chacun guette anxieusement le moindre remous, terrifié à l’idée de découvrir un nouvel animal abattu. Chaque disparition laisse un vide immense.
« Depuis le mois de février jusqu’à maintenant, nous avons déjà perdu au moins 15 hippopotames. Avec la période de mise bas, soit deux ans ou une année et demie, imaginez combien nous avons perdu juste dans 3 mois, c’est beaucoup », s’alarme Ladislas Witanene, assistant à la société civile environnementale.
Un sanctuaire naturel en péril
Un troupeau d’hippopotames se repose dans la rivière Ruzizi, au site de Katogota (Sud-Kivu). Katogota était devenu un pôle d’écotourisme fondé sur la présence de ces géants d’eau. Cette région abrite un écosystème aquatique remarquable, propice à l’installation de plusieurs dizaines d’hippopotames. En septembre 2023, le gouvernement congolais a officiellement classé ce site comme lieu touristique d’intérêt provincial, s’appuyant sur le suivi d’environ 45 animaux dans ce secteur.

Des organisations locales et l’administration provinciale ont investi plus de dix ans de travail pour faire de Katogota un modèle de tourisme communautaire. Le projet visait non seulement la conservation de l’espèce, mais aussi le développement socio-économique des villages reculés. Le gouvernement de Kinshasa avait souligné récemment qu’il fallait étendre ce programme jusqu’à Luvungi et au-delà, afin que « la province puisse en profiter » et transformer la biodiversité en richesse locale.
Avant la crise, Katogota attirait déjà des visiteurs désireux d’observer les hippopotames dans leur habitat naturel. Des guides locaux emmenaient des familles en pirogue sur la Ruzizi pour admirer ces beaux animaux aquatiques. Ce fort potentiel touristique constituait un espoir de revenus nouveaux pour l’ensemble de la région
Braconnage et insécurité
Le contexte sécuritaire instable dans l’est de la RDC offre un terreau favorable au braconnage organisé. Plusieurs sources impliquent des miliciens armés. Un rapport du 14 avril 2025 indique : « qu’au moins 15 hippopotames ont été tués et consommés par des groupes armés entre Katogota et Uvira ». Ces exactions se multiplient avec la guerre qui fait rage dans la région. La société civile qualifie ce phénomène « d’écocide très organisé », soulignant que l’hippopotame figure sur la liste rouge des espèces vulnérables.
Un récent accrochage armé a même opposé des soldats burundais à des miliciens congolais après l’abattage de quatre hippopotames sur la rive de la Ruzizi. La population d’hippopotames de la Ruzizi étant partagée avec le Burundi, on redoute qu’une extermination totale n’entraîne une plainte internationale contre la RDC. Ce drame, loin d’être un incident isolé, s’inscrit dans le cadre plus large des violences transfrontalières, outre les victimes animales, ce sont des tensions diplomatiques qui se créent autour de la biodiversité partagée.

Un hippopotame amphibie aux abords de la rivière Ruzizi. La disparition de telles populations a des conséquences lourdes sur l’écosystème et la biodiversité locale. Au plan écologique, l’élimination de ces grands herbivores bouleverse l’équilibre fragile de la rivière. L’hippopotame n’est pas « qu’un géant des rivières, c’est un acteur-clé de l’écosystème », rappelle un rapport de conservation.
En se déplaçant entre terre et eau, il transporte des nutriments et entretient la fertilité des berges, maintenant ainsi la diversité de la végétation subaquatique. Sa disparition massive provoquerait « un déséquilibre écologique majeur », menaçant directement la biodiversité locale ainsi que les activités humaines dépendantes de la rivière. Pêcheurs et agriculteurs craignent par exemple une prolifération d’algues et de moustiques, ou une baisse des poissons. À terme, l’ensemble de l’écosystème jusqu’aux poissons du lac Tanganyika pourrait être perturbé, avec des conséquences encore difficiles à mesurer.
Les investissements passés dans les infrastructures d’accueil (pontons, zones de pique-nique) risquent de ne jamais être rentabilisés. De plus, la perte de cette attraction naturelle décourage les opérateurs locaux : guides, restaurateurs et petits hôteliers dépendaient tous des visiteurs venus observer les hippos. À terme, c’est l’attractivité touristique de toute la province qui en pâtira, privant l’économie rurale d’une des rares sources de revenus durables.
L’impact social est également profond
« C’est plus de vingt ans de dur labeur qui sont anéantis. Les jeunes et les agriculteurs qui avaient investi du temps et de l’argent dans cette initiative sont désemparés », explique un responsable associatif local ayant gardé l’anonymat.
Il ajoute en disant que certains craignent que la colère ne se retourne contre les autorités locales, jugées trop lentes à réagir. Dans un contexte déjà marqué par la pauvreté, ce sentiment d’injustice risque d’attiser les tensions sociales. Les chants traditionnels célébrant autrefois l’équilibre entre l’homme et la nature résonnent désormais comme des plaintes d’impuissance.
Il sied de noter que, derrière ce drame local se profile un défi national, la RDC a réaffirmé son engagement international en matière de conservation. La sauvegarde du sanctuaire de la Ruzizi, longtemps salué comme un exemple de développement durable, exige désormais une action collective et résolue. Seule une mobilisation concertée de tous les acteurs (gouvernements, communautés locales et ONG) peut faire rimer la perte subie avec un avenir durable pour la faune et la flore de Katogota.
Elie CIRHUZA
En savoir plus sur Mkulima Média
Subscribe to get the latest posts sent to your email.